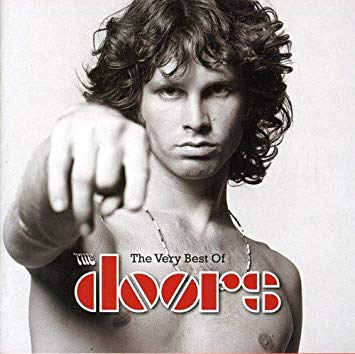Adaptation fidèle au livre de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux préfère le romanesque au naturalisme. Les rêves et les désillusions d’une jeunesse des années 1990 se dévoilent, avec une folle envie de cinéma.
Quatre étés des années 90. Les quatre tentatives d’Anthony (Paul Kircher), adolescent gauche et timide, pour séduire Steph (Angelina Woreth) se heurtent à ses quatre confrontations avec Hacine (Sayyid El Alami). Parmi les témoins de cette histoire d’amour hésitante et cette rivalité violente, on compte les parents, minés par l’alcool et la morosité, et la bande d’amis fêtards et désinvoltes. Quatre étés rythmés, entre autres, par Nirvana, Aerosmith, les Red Hot, Francis Cabrel et I Will Survive.
Le duo de réalisateurs (Ludovic et Zoran Boukherma) choisissent de ne pas s’affranchir de la structure du roman pour suivre l’évolution, avec ellipses donc non-dits, de leurs personnages. Si Paul Kircher convainc dans le premier été en ado maladroit, la construction de son personnage par faux réflexes (mains dans les cheveux, posture penchée) révèle un jeu moins spontané que ses camarades. Leurs enfants après eux révèle surtout le formidable Sayyid El Alami dans un rôle risqué qui aurait pu virer au stéréotype. Acteur à suivre de toute urgence donc.
Les années se succèdent dans les trous du récit et l’on découvre à chaque chapitre nos (anti)héros grandis. Du côté des personnages secondaires le film embrasse un discours social plutôt pessimiste, où chaque personnage persévère dans une nature suggérée d’emblée. Le père d’Anthony (Gilles Lellouche) plonge chaque été davantage dans l’alcool, et Hacine, dans la violence.
Pourtant, malgré la noirceur de son sous-texte, le film refuse l’apitoiement ; les espoirs déçus et les drames s’amenuisent avec le temps. La caméra des frères Boukherma injecte du romanesque et de la grandeur dans un quotidien plombé par l’ennui, transcendant les trajectoires douloureuses de leurs personnages. La bande-son rock témoigne d’une volonté de fantasmer la vie plutôt que de se contraindre à une représentation réaliste. Les scènes de bagarre sont imprégnées de souvenirs cinématographiques, les travellings et plans à la grue suivent nos héros avec une précision d’orfèvre, comme pour crier dans chaque plan que tout ceci reste du cinéma.
Ce parti pris de la fiction époustouflante au détriment du naturalisme permet de faire accepter les petites invraisemblances. Leurs enfants après eux refuse les zones d’ombre et les incohérences, marques du réalisme, pour préférer la logique implacable d’un scénario qui boucle tout sur lui-même. Aussi le film, comme le roman par ailleurs, ne craint pas la lourdeur de certains symboles. A titre d’exemple : la rivalité entre Anthony et Hacine se résout en juillet 98, lors d’une demi-finale remporté par l’équipe black-blanc-beur.
Néanmoins, le film n’enjolive pas les années 1990, rappelant aussi les maux de la « France périphérique » (Christophe Guilly). Outre l’alcoolisme du père d’Anthony et l’addiction à la clope de la mère présentée avec de gros sabots, le film séduit par ses rappels discrets de la réalité sociale comme Steph, en larmes à la fin de sa première année d’études, constatant que ses camarades parisiens sont formatés à la réussite scolaire là où elle sera toujours menacée de retourner en Moselle au premier échec.
La jeunesse balaiera toutes ses déceptions. Faire l’amour et la fête l’emporteront toujours sur les rêves contrariés. Avec malice, le film se clôt sur Born to Run de Bruce Springsteen, résumant tout le récit.