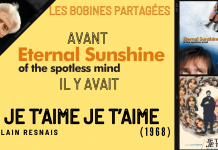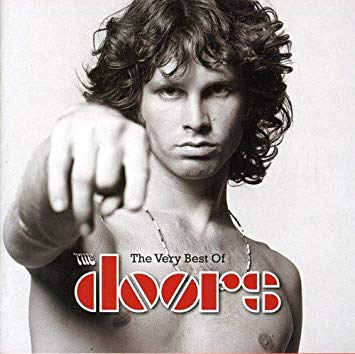Après s’être plongé dans les origines du cinématographe dans Lumière ! L’aventure commence, Thierry Frémaux, qui délaisse les avant-premières cannoises pour le cinéma des premiers temps, se fait passeur des films de Louis Lumière. Il en relève la cohérence, les coups d’éclats, et la beauté. Louis Lumière n’est pas seulement le premier cinéaste, il est aussi l’auteur de la première œuvre du cinéma.
Le dispositif de ce documentaire de Thierry Frémaux a le mérite de l’efficacité. Rythmés par la musique de Gabriel Fauré, contemporain des Lumières, les films de Louis, qu’on a longtemps appelés des « vues », se succèdent, commentés par la voix de Thierry Frémaux. Cette déambulation dans les premiers films de Louis Lumière s’organise autour de regroupements thématiques (foules, enfants, militaires, transports, voyages…), choix risqué qui compte sur le spectateur pour s’intéresser à parts égales à chaque séquence.
Thierry Frémaux veut nous faire redécouvrir l’œuvre de Louis Lumière, trop associé à son statut de pionnier qu’à son regard de cinéaste. Dès le générique, il réussit son pari. Agrandie, rénovée, et ralentie, la séquence fameuse de la sortie de l’usine Lumière émeut par les sourires des ouvriers, leurs regards caméra complices et amusés, un chien qui bouscule des femmes… un fragment de vie, enfin capturée à jamais. Thierry Frémaux ne s’attarde pas sur le bouleversement révolutionnaire de l’invention du cinématographe. Pourtant, le titre de la dernière séquence, « La mort cessera d’être un absolu » (tiré d’un article sur la première projection), laissait espérer un commentaire poétique sur cette émotion qui nous saisit devant les films de Lumière, cette impression de voir, enfin, nos ancêtres-fantômes, qui, grâce à leurs mouvements immortels, appartiennent à la même temporalité que nous.
Lumière ! L‘aventure continue se concentre sur les divers bouleversements nés de l’invention des frères Lumière. S’il y a un film, il leur faut un public. Pour créer ce public, il leur faut des lieux etcetera. Ainsi, Thierry Frémaux raconte avec simplicité, sans jamais assommer d’érudition, la naissance du cinéma comme pratique sociale.
Additionné à cette visée didactique historique, le documentaire déploie une seconde visée, plus inédite et émouvante : celle de nous convaincre que Louis Lumière ne fut pas qu’un inventeur, mais avant tout un cinéaste. Frémaux rappelle, en substance : « Louis Lumière se pose une question que se posera tout réalisateur après lui : où poser sa caméra ? ». Lumière ne saisit pas seulement des vues, comme s’il lui suffisait de prendre un fragment de réel, mais il voit, dans la réalité, un possible film. Les contraintes sont nombreuses : durée de moins d’une minute, caméra fixe, pas de son… mais Lumière s’en accommode et détourne même la deuxième, en posant sa caméra sur divers moyens de transport, donnant naissance aux premiers mouvements panoramiques de l’Histoire.
Ces vues de Lumière portent bien leur nom, car l’homme a un regard. On devine des lieux de prédilection et des thèmes chers. Souvent, sa caméra se positionne au croisement de rues, à des lieux de passages, pour que le plan fixe s’emplisse tout de suite de plusieurs mouvements. En homme de son temps, Lumière se passionne pour les moyens de transport moderne, aussi nombreux sont les plans pris depuis l’arrière ou l’avant d’un train, depuis un bateau, ou tout autre structure permettant le mouvement, comme un étonnant toit roulant. A cette fascination pour les transports répond, logiquement, celle pour les foules, continuation de cette obsession pour le mouvement dans ce qu’il a de plus spontané. Ce goût de Lumière pour la foule ouvre la voie à Murnau, Griffith et Abel Gance.
Pour capturer cette vitesse, Louis Lumière ne dispose que de cinquante-cinq secondes, durée paradoxalement courte pour un film complet, et longue pour un plan. Cependant, Lumière, en premier cinéaste, saisit les potentialités de cette petite minute pour laisser les mouvements se déployer. Une vue stupéfiante nous immerge dans un champ de bataille, où un régiment de cavalerie fonce vers nous, avant de se disperser dans un chaos de poussière, laissant enfin un décor désert. Lumière comprend, alors que son invention balbutie encore, qu’un long plan fixe suffit à raconter, à saisir le réel, et surtout, à éblouir.
La fin du documentaire regorge de séquences à couper le souffle. Ces pêcheurs, filmés en plongée, qui tirent lourd filet, grands-pères des marins de La Terre Tremble de Visconti. Ces soldats qui dévalent une colline dans de curieux serpentins. Ce paysan, au centre d’une image fortement animé, qui charrie des ballots de foin. Peut-être la plus belle image du film, ces cavaliers qui montent à tour de rôle un cheval blanc qui galope en cercle, alors qu’on devine au loin dans la brume, le château de Prague.
Thierry Frémaux rappelle avec humour les ratés de Lumière, et son regard tendre transmet sa passion pour Lumière, sans le sanctifier. Il rappelle avec justesse l’apport de Georges Méliès au cinéma, et sans opposer les deux réalisateurs, fait de Méliès le fondateur du cinéma-spectacle, du septième art circassien (et Fellini s’en souviendra), de l’esprit hollywoodien ; et de Lumière, le grand-père du néo-réalisme, de la Nouvelle Vague, du cinéma-vérité, du réalisme et de la durée, sans qui Abbas Kiarostami, Chantal Akerman, Robert Bresson et Agnès Varda n’auraient pas vu le jour.
Peut-être trop bavard et explicatif, Thierry Frémaux nous guide dans cette exploration gourmande des œuvres de Lumière, dans la lignée du grand passeur que fut Bertrand Tavernier. Son film Lumière ! L’aventure continue, fort de de la restauration somptueuse des vues, nous présente enfin, avec sincérité et amour, l’apport non plus seulement technique de Lumière, mais surtout esthétique, sensorielle, et émotionnelle. Le documentaire nous l’avait martelé jusqu’à ce qu’on conjure ce non-dit de l’Histoire du cinéma : Louis Lumière fut bien le premier cinéaste.
(De plus on découvrira dans ce film qu’Alain Chabat avait joué chez Coppola, raison n°125 de voir ce film)
Image de l’article : Copyright Institut Lumière