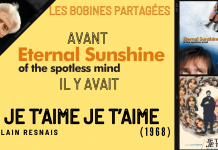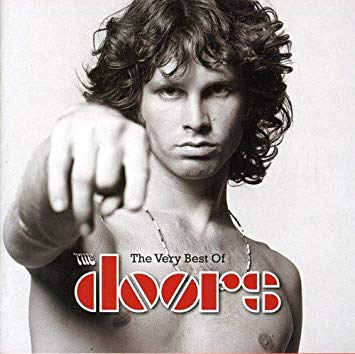Une caméra s’immisce dans deux bandes de jeunes lycéens. La première, dans Ce n’est qu’un au revoir se heurte à la fin de la terminale, aux adieux inévitables, à la nostalgie des derniers moments ensemble. La deuxième, dans le plus court Un pincement au cœur, raconte le même déchirement d’une séparation à venir, mais en montrant la difficulté de l’avouer, la difficulté d’admettre l’importance d’une amitié. Leur réalisateur, Guillaume Brac, discrètement, capture les doutes d’une jeunesse en fin d’enfance, ainsi que ses certitudes de futurs adultes. Des rencontres émouvantes, qui saisissent avec brio deux jeunesses.
Ce n’est qu’un au revoir (2024) dure près d’une heure, et Un pincement au cœur (2023), à peine trois quarts d’heure. Guillaume Brac décide intelligemment de les projeter ensemble, d’abord le plus récent, sur une bande de terminales, internes d’un lycée dans la verte Drôme, puis le plus court, sur des lycéennes plus jeunes, tentant de rompre l’ennui d’Hénin-Beaumont. Cet ordre astucieux permet d’être touchés par ces jeunes drômois, militants écolo et chahuteurs, mais de ne pas étendre la conscience politique à tous les jeunes. Dans Un pincement au cœur, les filles discutent de leurs problèmes de cœur, d’amitié, de cours, soient des sujets qui ne dépassent pas leur lycée, mais jamais nous ne les jugeons, du fait de ce contraste envers leur environnement de béton et de lassitude, et celui, verdoyant et optimiste de la jeunesse rurale de la Drôme. Chaque tourment de la jeunesse se trouve légitimé dans ce choix subtile de programmation.
Dans Ce n’est qu’un au revoir, Guillaume Brac donne la parole aux jeunes, qui chacun leur tour, en voix off, délivre leur histoire. On se rend compte bien vite que la fin d’année, et son lot de manques à venir, coïncide avec leurs témoignages, tous centrés sur une absence. Absence de parents défaillants, absence d’une sœur disparue, absence de réponse politique ferme face à la crise climatique. De même, Un pincement au cœur anticipe une absence future, celle d’une meilleure amie qui déménagera à la rentrée suivante. La jeunesse n’est donc pas que cet âge tendre où l’on se marre à l’internat en dégringolant sur des matelas piqués au voisin, mais résonne aussi une mélancolie.
Le montage précis des deux films se situe dans un équilibre parfait entre ces tiraillements intimes des jeunes, et leurs moments de franche rigolade et d’insouciance. Dans Ce n’est qu’un au revoir, Guillaume Brac se plaît à dévoiler les combines universels des jeunes : visite secrète à l’étage des garçons dans l’internat, traversée foireuse en autostop, batailles d’eau… avant qu’une voix off ne vienne contrebalancer ces rires par un récit intime plus douloureux. Dans Un pincement au cœur, le dispositif insiste sur les discussions existentiels entre les deux jeunes filles, débattant de la méfiance envers les garçons, ou la crainte de l’attachement.
Dès que l’intertitre introductif nous situe le deuxième court-métrage à Hénin-Beaumont, impossible de ne pas penser à la situation politique de cette ville, fief de Marine Le Pen et bastion de l’ascension de l’extrême-droite. Jamais les deux filles ne parlent de politique, à la différence des jeunes drômois prêts à faire quinze heures de stop pour manifester près des bassines de Sainte-Soline. Insidieusement, cette absence du discours politique dans la bouche des jeunes symbolise ce délaissement des petites villes du Nord, bétonnées, repliées même géographiquement sur elles-mêmes. Les deux filles d’Un pincement au cœur avouent à la psychologue du lycée leur vive angoisse de l’ennui, suggérant malgré elle l’enclavement d’Hénin-Beaumont.
Guillaume Brac ne surligne rien dans sa mise en scène. Ses plans fixes, purs retranscriptions du réel, laissent la parole aux jeunes, et au groupe. Les deux moyens-métrages débordent d’affection pour la bande d’amis, cette entité indéfinissable, substitut de la famille, espace de confiance absolue, comme d’oubli possible de soi. La bande, communauté mouvante, se disloque temporairement en trios ou en duos, ou bien s’étend et accepte d’autres membres. Être garçon ou fille n’a pas d’importance, seul compte l’alchimie entre un et les autres, manifeste par les discussions complices, les gestes fraternelles, les chamailleries taquines. Gardant la désinvolture de l’enfant, mais saisissant la complexité du monde et des sentiments comme des adultes en devenir, ces jeunes filmés par Guillaume Brac nous émeuvent, nous font diablement rire et rappellent à chacun cet âge doux-amer de la fin de l’adolescence.
Droits image de l’article : Copyright Condor Distribution