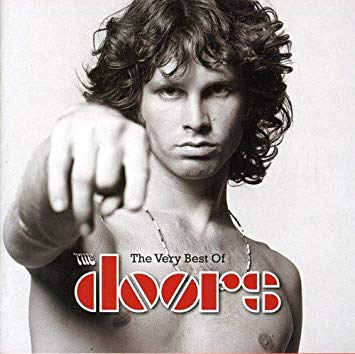Flamboyant mais confus, le dernier film de Jacques Audiard avait tout du pari (trop) risqué. Une comédie musicale, en espagnol, sur la transition de genre et les cartels au Mexique, voilà qui détonnait fort. En résulte un film généreux, parfois virtuose mais malhabile dans la juxtaposition de toutes ses histoires. Au-delà des genres, à tout point de vue.
Nul doute que Jacques Audiard a dû trimer pour obtenir des financements. Qui se risquerait à financer cet ovni, au propos politique risqué ? A la vue du générique, Yves Saint-Laurent majoritairement. Qu’importe, saluons la prise de risque du réalisateur, qui nous avait plutôt habitué aux films sombres (Un prophète, De rouilles et d’os).
Après le western (Les Frères Sisters), Jacques Audiard s’attaque à un autre film de genre pour ironiquement, déconstruire les normes. Dans cette comédie musicale étonnante, Zoe Saldaña est une avocate talentueuse, Rita, dans l’ombre de son patron et de ses clients véreux. Un mystérieux appel téléphonique lui promettant gloire et argent la plonge dans un dangereux cartel mexicain. Elle rencontre Manitas del Monte, chef du gang en question, qui lui demande de l’aider… à devenir une femme. Quatre ans plus tard, l’avocate recroise le chemin de sa cliente, femme superbe et épanouie renommée Emilia Perez (Karla Sofia Gascon).
Après une scène d’ouverture éblouissante qui n’est pas sans rappeler l’introduction d’Annette de Leos Carax, nous voilà entrés dans un récit mené tambour battant. Les séquences se suivent à un rythme frénétique, passant d’un tableau à l’autre sur un pas de danse. Les plus réticents au genre musical frissonneront devant le kitsch assumé de certains morceaux, la Palme allant au passage chez les chirurgiens, sommet d’artifices.

En ouverture d’Annette comme d’Emilia Perez, le personnage principal chante dans la rue, suivie par un choeur. Une ouverture d’emblée artificielle qui célèbre l’illusion que nous devons accepter devant toute comédie musicale.
Très vite, ce rythme trépidant produit un contrecoup. La succession ressemble à un enchaînement, plus mécanique que cohérent. Pourtant, le scénario réduit la vie complexe d’Emilia à des arcs narratifs simples : ascension, rédemption, chute. Seulement, ces périodes ne sont pas infusées les unes dans les autres avec une discrète logique, mais plutôt plaquées avec franchise, comme si le geste effacerait la confusion. Du cartel nous voilà arrivés à l’ONG, des réunions de famille nous voici à la réunion d’entreprise.
L’autre échec du film tient paradoxalement à ses personnages. Emilia Perez éclipse Rita, dont la trajectoire suit davantage celle d’un personnage secondaire. Passive, elle répond aux ordres et peine à incarner une vraie girl boss à laquelle le film veut nous faire croire. Elle clame des slogans militants en chanson comme si le film tentait d’en faire une figure politique forte, mais le scénario résume ses motivations à l’appât du gain. Cette distance permet néanmoins un discours subtil et troublant sur la condition féminine, chantée en karaoké par Selena Gomez devant une Rita désemparée : et si être une femme, c’était lutter pour s’aimer ?
A côté de ce défaut de rythme et à la création perfectible de son personnage principal, Emilia Perez offre quelques moments de bravoure. Les tableaux les plus réussis sont les plus intimes, comme Emilia bordant son fils au lit, et les plus spectaculaires, comme Rita dénonçant les hypocrisies des élites debout sur des tables à un gala de charité. ; ou encore les millions d’anonymes réunis sur fond noir, comme des étoiles à la lumière ternie.
A l’instar de ces moments juxtaposés plutôt que liés avec cohérence, les propos politiques s’additionnent avec facilité, mais sans en faire trop. Le film distillerait presque un sous-discours plus sombre sur la place des femmes pauvres, réduites aux choeurs et aux arrière-plans quand elles sont femmes de ménage, mais il ne va pas plus loin dans la contestation.
Dans cette confusion de musiques et de chants, Jacques Audiard arrive à sortir la tête de l’eau en s’appuyant sur un montage maîtrisé, non sans quelques audaces curieuses, pour ne pas dire faux raccords et raccords dans l’axe maladroits. Cependant, la fougue du film embrasse pleinement son propos politique ; sa confusion peut faire écho à la fluidité des genres et des identités, à la façon d’un Almodóvar. L’influence du cinéaste espagnol se fait aussi sentir dans les moments mélodramatiques et la tentation d’un ridicule de télénovela.
Malgré l’incohérence globale du film qui n’est ni le meilleur film de Jacques Audiard, ni un sommet de la comédie musicale, saluons la prise de risque salutaire d’un cinéaste qui cherche à se renouveler et à mettre en lumière des femmes puissantes. Sincère, voilà un réalisateur qui ne fait pas genre.