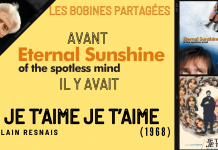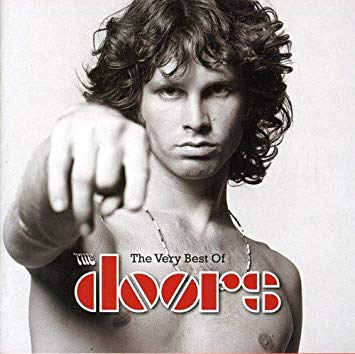par Manon Grandières
Un film qui commence par Fontaines D.C. et se clôt avec The Verve ne pouvait que me séduire. Au-delà de sa BO, Bird émeut d’abord par son portrait frappant des classes défavorisées du Royaume-Uni. Cependant, son réalisme brut n’empêche pas des incursions inattendues et salvatrices vers le fantastique. Une nouvelle façon, pour Andrea Arnold, de prendre son envol.
Sale journée pour Bailey (Nykiya Adams, à suivre absolument). Son père (Barry Keoghan) lui annonce son mariage imminent avec sa compagne qui devrait débarquer avec sa jeune fille dans l’appartement-squat habité par Bailey, son frère et leur jeune paternel. Comble du malheur pour cette ado renfermée et plus attirée par les sweats à capuche que par les paillettes : son père la force à porter un hideux ensemble rose panthère. Elle passe la semaine précédent le mariage à fuguer au gré de ses envies. Elle rejoint tantôt un gang violent formé par des garçons à peine plus vieux qu’elle, tantôt ses autres frères et sœurs. Lors d’une escapade, Bailey rencontre Bird, jeune homme à première vue marginal, détonnant dans ce morose paysage…
La caméra nerveuse d’Andrea Arnold, portée à l’épaule pour souligner les accrocs, suit Bailey dans ses errances. Ce dispositif embrasse pleinement la violence de son quotidien, balayant d’un mouvement les habitations précaires, taguées de toute part, et ses locataires, tous pauvres. A chaque course ou départ furieux de la jeune ado, la caméra la traque. Le spectateur s’habituera à ces très gros plans et ces tressautements du cadre, qui, dans le cinéma réaliste voire naturaliste, sont souvent légion.
Seulement, Andrea Arnold insère des images nouvelles, créées par Bailey avec son téléphone portable. Là où beaucoup de films censés se dérouler dans notre époque se montrent frileux dans l’utilisation de smartphones, parfois même évincés des intrigues et des plans ; Andrea Arnold fait des vidéos filmées par son héroïne une voie poétique possible. Bailey projette ses courts films sur le plafond de sa chambre, trouvant une respiration avec ses moments contemplatifs. Souvent, elle filme la nature, les animaux, comme un contre-pied romantique à son quotidien de tours d’immeubles, de béton et d’autoroutes.
Sa rencontre avec Bird marque une rupture dans le régime d’images. La caméra d’Arnold se pose enfin, comme une continuation dans la vie réelle du calme recherchée par Bailey dans ses films. Bird incarnera cette sérénité impossible. Impossible car Bailey ne peut échapper à la violence constante de son environnement.
Cette violence rôde, la guette et s’invite peu à peu avec plus de force. Bailey épie un passage à tabac, sombre prémonition d’une scène future. Andrea Arnold lie discrètement ses bagarres d’abord commises par le jeune gang à un imaginaire de cinéma. Le frère aîné de Bailey se filme avec un masque de clown vengeur sur le visage, la bande se voit comme des justiciers répondant à la violence des hommes par la violence, reprenant là une rhétorique de films d’horreur.
Surtout, et c’est là qu’Andrea Arnold confirme son statut d’observatrice affutée des classes défavorisées anglaises, la violence insidieuse de la précarité ressurgit dans chaque plan. Au travers des dialogues, traversés par un argot difficilement appréciable pour nous, Frenchies. Au travers des décors, en priorité, entre squat aménagé, écrans omniprésents, détritus et joyeux bordel. Au travers des interprètes, à quelques exceptions, sont tous de très jeunes gens. En témoignent la profusion de surnoms pour se désigner : Bug, Bird, Skate… La réalité de Bailey est celle d’un monde créé par des enfants. Des enfants à qui trop de responsabilités sont confiés.
Pourtant, plutôt qu’un constat figé de la misère, Bird s’avère un récit d’apprentissage. Andrea Arnold n’amenuise pas la violence de la pauvreté, mais refuse de la traiter par la pitié. Son film offre ainsi des échappés lumineuses à son personnage principal.
Bailey, aussi revêche qu’attachante, semble fuir son quotidien, mais en réalité, elle lutte. Elle s’élève contre le monde, contre les autres, pour affirmer sa liberté et protéger les siens. Lorsque la réalité s’avère trop douloureuse, le fantastique surgit, comme un filtre. Aussi Bird s’éloigne d’un réalisme attendu pour proposer un récit surprenant, où se mêlent les genres et les régimes d’image. Son portrait de la jeune Bailey n’en est que plus complexe, et plus intense.
Le film explore peut-être de trop nombreuses pistes, entre frontière floue entre masculin et féminin, violence masculine, appel de la nature, famille reconfigurée, quête de paternité… mais la figure de Bailey saisit toutes ces dimensions, tous ces contraires. La suivre au rythme de la caméra libre d’Andrea Arnold reste une fugue bouleversante, en forme de demi envol.